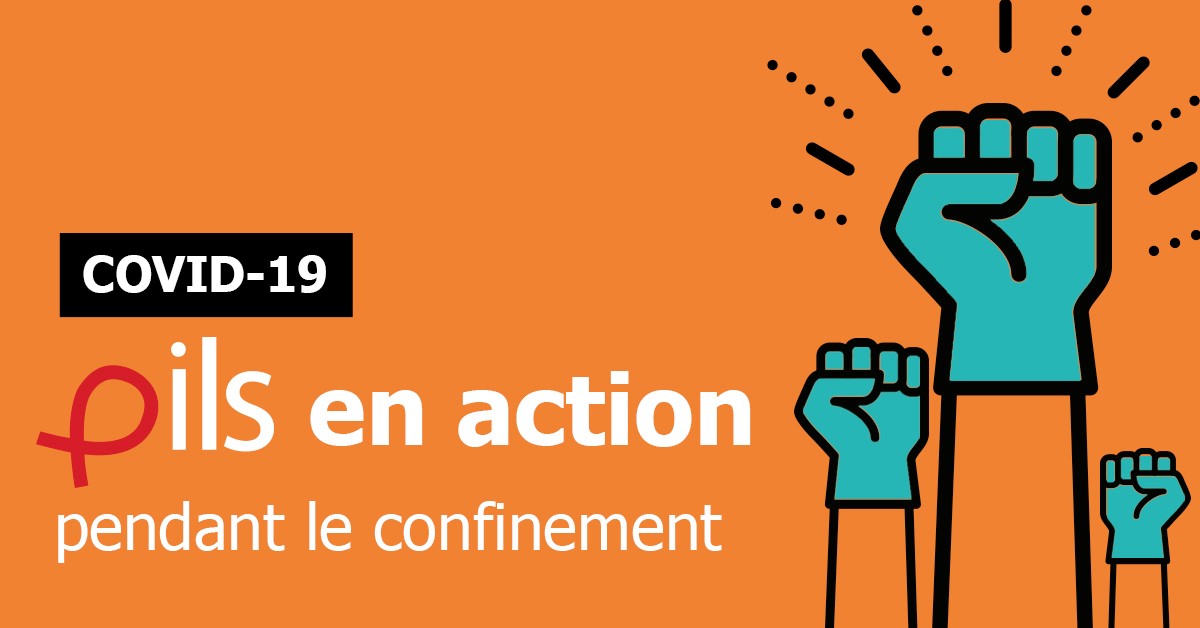PILS a inauguré le centre Banian, le premier centre de santé sexuelle communautaire à Maurice ce 1er décembre, à l’occasion de la journée mondiale contre le sida. Ce projet innovant est mis en œuvre en collaboration étroite avec le ministère de la Santé. Il accueillera une panoplie de services de santé liés au VIH, à l’hépatite C et aux infections sexuellement transmissibles, dans l’idée d’une «one-stop shop» décentralisée.
Installé au centre communautaire Nou Vi La de PILS, à Port-Louis, le Banian est ouvert aux populations vulnérables à ces infections et au grand public, dans l’optique d’assurer un égal accès à ces services de santé.
« Au sein de cette structure unique en son genre, la complémentarité santé publique-société civile sera en action, chacune étant dans son domaine d’expertise. Le ministère de la Santé prend en charge l’aspect médical et PILS, à travers un accompagnement de proximité, le suivi et le soutien psychosocial si essentiels au maintien dans le soin », indique Annette Ebsen Treebhoobun, directrice exécutive de PILS.
« Nous sommes interdépendants », a souligné le Dr Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé, lors de l’inauguration.

La stigmatisation, un obstacle majeur
« Cette journée mondiale de lutte contre le sida est placée sous le signe de l’égalité maintenant. Pour rappeler que la stigmatisation et les discriminations, qu’il s’agisse de VIH, d’usage de drogue, d’orientation et de pratiques sexuelles, ont toujours cours, en particulier à l’encontre des populations les plus exposées », a rappelé Thierry Arékion, président du conseil d’administration de PILS lors de l’inauguration.
L’ouverture du centre de santé sexuelle communautaire Banian est « une association exemplaire » de l’État et de la société civile, a souligné le Dr Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé, lors du lancement.
C’est également l’occasion « de lancer et de maintenir une discussion, une prise de conscience nationale sur l’importance de l’éducation sexuelle et émotionnelle, afin que chacune et chacun puisse prendre soin de sa santé », estime Annette Ebsen Treebhoobun.
Faut-il encore le rappeler : une personne avec une charge virale indétectable ne transmet pas le VIH. « Qu’il s’agisse de VIH, d’hépatite virale ou d’IST, être informé-e, se faire dépister, se faire soigner, c’est l’assurance de continuer à vivre, et vivre bien », a poursuivi la directrice exécutive de PILS.

Les services disponibles au centre Banian

PILS sera désormais en mesure d’effectuer des tests médicaux et renforcera sa structure de soutien au niveau psychologique, et social aux populations prioritaires dans la lutte contre le VIH (les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, en particulier les femmes transgenres, les travailleurs-ses du sexe, les personnes usagères de drogues par injection, les personnes vivant avec le VIH, les personnes incarcérées ou en détention) mais aussi à la population générale pour réduire et contrôler les nouvelles transmissions du VIH et des infections sexuellement transmissibles.
Le centre Banian s’adresse au grand public en proposant, avec l’appui du personnel de la Santé publique, dépistage, suivi, prévention, counseling, du VIH, de l’hépatite C et d’infections sexuellement transmissibles, aux côtés des services habituels offerts par les équipes de PILS.
- Hépatite C : initiés au centre Nou Vi La depuis février 2022, le dépistage, le suivi et le traitement de l’hépatite C continuent d’être assurés par le personnel du ministère de la Santé les mardis et jeudis
- VIH : le personnel de la AIDS Unit sera présent 2 fois par semaine pour dispenser les services VIH qui étaient jusqu’ici disponibles uniquement dans les Day Care Centres for the Immuno suppressed comme les tests de confirmation, la prise en charge médicale et le suivi des personnes vivant avec le VIH, la mise sous PrEP (traitement préventif contre le VIH) et le suivi médical.
- Le dépistage et le suivi médical des personnes souffrant d’infections sexuellement transmissibles (syphilis, gonorrhée…) ou ayant des problèmes de santé sexuelle ou généraux, par des médecins généralistes, avec référencement vers des spécialistes au besoin.
Lire aussi
- le communiqué de PILS dans son intégralité ici
- le discours de Thierry Arékion, président de PILS
- le discours d’Annette Ebsen Treebhoobun, directrice exécutive de PILS