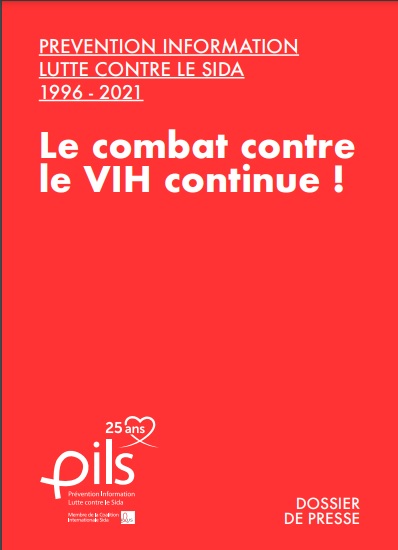AIDS Candlelight Memorial 2022
« Nou rapel, nou azir, nou pou sirmont VIH »
Port-Louis, 13 mai 2022 — Le 15 mai, une centaine d’organisations communautaires et des milliers de personnes participeront à des événements dans plus de 115 pays pour soutenir la 39e veillée internationale, l’« AIDS Candlelight Memorial ». À Maurice, PILS et d’autres organisations communautaires de lutte contre le sida se rassembleront pour commémorer les personnes décédées depuis le début de l’épidémie et pour exprimer leur solidarité avec celles et ceux vivant avec et affectées par le VIH.
Après deux confinements dus à la Covid-19, ce moment fort de sensibilisation et de mobilisation se tiendra à nouveau en présentiel. Nous nous retrouverons au centre communautaire Nou Vi La de PILS, le dimanche 15 mai, de 17 heures à 19 heures, sous le thème retenu depuis 2020 : « Nou rapel, nou azir, nou pou sirmont VIH ». Il nous rappelle la nécessité d’une approche basée sur la responsabilité individuelle et collective et le respect des droits humains dans la riposte contre le VIH et la Covid-19.
Au programme de cette soirée : projection d’un film lié au VIH, suivi des témoignages de personnes affectées par le VIH.
Le VIH à Maurice
À Maurice et ailleurs, la pandémie du nouveau coronavirus a mis à mal les progrès effectués contre le VIH, alors même que grâce aux avancées de la recherche et de la médecine, nous disposons des connaissances et des outils pour mettre fin à l’épidémie de VIH en tant que menace de santé publique d’ici 2030.
Le constat est alarmant, les progrès réalisés entre 2010 et 2015 ont été inversés depuis 2015 :
-
Les décès liés au sida ont augmenté de 25 % entre 2015 et 2019
-
141 décès liés au sida ont été enregistrés à Maurice en 2020
-
Hausse de 16 % des nouvelles infections par le VIH entre 2015 et 2019
-
L’épidémie se généralise : près de deux tiers des nouvelles infections en 2020 concernent des personnes hétérosexuelles
-
Le nombre de nouveaux cas détectés chez les jeunes de 15 à 24 ans, reprend la pente ascendante, passant de 15 % en 2018 à 18 % en 2020.
De nombreux facteurs favorisent la progression du VIH, dont : un niveau élevé de stigmatisation et de discrimination en particulier à l’encontre des populations les plus exposées au VIH ; le manque d’accessibilité aux services de prévention, de traitement, de soins et de soutien ; la précarité ; et les lois répressives en matière de consommation de drogues.
Pourtant, aujourd’hui grâce à la trithérapie, une personne séropositive sous traitement, avec une charge virale indétectable, ne transmet plus le virus et peut avoir une bonne qualité
de vie.
La cascade de soins du VIH à Maurice
Les données montrent que les progrès réalisés pour atteindre les objectifs 95-95-95 d’ici 20301 sont faibles. Sur les 14 000 personnes estimées vivant avec le VIH, environ 46 % [39-54] connaissent leur statut sérologique. Parmi elles, 21 % [18-25] ont accès au traitement antirétroviral (ARV) et 15 % [13-18] d’entre elles ont une charge virale supprimée (UNAIDS Spectrum, 2020). En 2021, parmi les 4 311 personnes initiées au traitement ARV, seules 3 088 y adhéraient et de celles-là, 1 869 avaient une charge virale indétectable (statistiques obtenus auprès du ministère de la Santé).
Du diagnostic au traitement, des lacunes à combler
Le dépistage est la première étape du parcours de soins. Une fois le diagnostic posé, une mise sous traitement précoce est recommandée. Malheureusement, la mise sous traitement le jour même d’un diagnostic positif via dépistage rapide n’est pas possible.
« Il y a un décalage entre le nombre de personnes dépistées et le nombre de personnes dans la file active2, comme le montre la cascade du VIH. Le problème majeur est d’ordre structurel car l’initiation au TAR le jour même n’est pas possible parce qu’après un test individuel positif au VIH via un test rapide, des échantillons sont prélevés et envoyés au Laboratoire central pour confirmation. La confirmation des résultats prend entre deux semaines et un mois. Durant cet intervalle, un nombre important de personnes ne reçoivent jamais leurs résultats3, donnant lieu à un nombre important de perdu·e·s de vue. » (Extrait des consultations communautaires menées dans le cadre du projet RIPOSTE, mis en œuvre par PILS)
La dispensation et le suivi des traitements, disponibles uniquement dans les cinq hôpitaux régionaux de l’île Maurice, restent un défi majeur. Ce qui freine l’accès aux services :
-
l’éloignement des centres de santé où les ARV sont dispensés du domicile des personnes vivant avec le VIH,
-
le manque d’infrastructures appropriées,
-
l’impossibilité de bénéficier d’ARV sur une durée de plus de deux mois,
-
le fort taux de stigmatisation associé à la fréquentation des centres de santé dédiés (DCCI), peu importe le statut sérologique.
En raison de ces obstacles, certaines personnes sont perdues de vue à chaque étape du parcours de soins. Ces lacunes durant ce cheminement dans les systèmes de santé doivent être reconnues afin que des interventions ciblées et des programmes puissent être élaborés pour les surmonter et ainsi s’assurer que les personnes vivant avec le VIH puissent atteindre le but ultime de la suppression virale.
Il est primordial de s’attaquer aux lacunes de la cascade avec une approche globale qui inclut :
-
la prévention (préservatifs, prophylaxie pré-exposition ou PrEP, traitement post-exposition ou PEP, dépistage, les programmes de réduction des risques),
-
le traitement (TasP, traitement comme prévention), et
-
les efforts pour créer un environnement favorable à la prise en charge dans le respect des droits humains peuvent contribuer à une baisse des décès liés au sida et des nouvelles infections causées par le VIH.
La stigmatisation en milieu hospitalier,
un obstacle majeur à l’amélioration de la qualité de soins
Si la stigmatisation et la discrimination liées au VIH à Maurice sont en baisse, il n’en demeure pas moins que le niveau de confiance des personnes vivant avec le VIH est relativement faible envers les institutions médicales. C’est une barrière à la prise en charge. Le rapport d’enquête sur l’indice de stigmatisation de 20184 a révélé que 10,4 % des répondant·e·s ont déclaré s’être vu·e·s refuser l’accès aux services de santé en raison de leur statut VIH (comparativement à 28 % en 2013) et que 16,1 % ont déclaré que les travailleur·se·s de santé avaient divulgué leur séropositivité sans leur consentement (contre 26,8 % en 2013). De plus, 41,7 % des répondant·e·s ont évité de se rendre à l’hôpital pour se faire soigner en raison de leur statut sérologique, et 30,4 % craignaient de recevoir un mauvais traitement par les pourvoyeur·se·s de soins à cause de leur statut sérologique. La discrimination à l’égard de la population LGBTI est également préoccupante.
Des progrès trop lents
Grâce au plaidoyer mené par PILS depuis 25 ans, des progrès ont été accomplis tels que l’introduction des traitements ARV gratuitement et des programmes de réduction des risques, la diversification des outils de prévention, le dépistage démédicalisé et l’amélioration de la prise en charge. Cependant, alors que la pandémie de Covid-19 fragilise les systèmes de santé et déplace les priorités en termes d’engagement sanitaire, politique et financier, il est important de rester vigilant·e et de ne pas tenir pour acquis les progrès réalisés ces dernières années. Une volonté politique ainsi qu’un engagement et une collaboration multisectoriels et à tous les niveaux sont nécessaires pour accélérer la riposte contre et en finir avec l’épidémie de VIH.
– FIN –
À propos de PILS : Fondée en 1996, PILS est une association de lutte contre le sida. Notre mission première d’être une structure de soutien aux personnes vivant avec le VIH à Maurice a évolué pour inclure également celle de représenter, mobiliser et renforcer les ONG et les communautés vulnérables de Maurice pour qu’elles militent, à travers le plaidoyer, pour un engagement politique, pour améliorer la réponse nationale au VIH et aux hépatites virales dans un environnement favorable au niveau national, régional et mondial, et pour mettre fin à la stigmatisation et aux discriminations des personnes infectées, affectées ou vulnérables au VIH et aux hépatites virales.
Contact presse : Rachèle Bhoyroo






 nos intervenant
nos intervenant d’aide
d’aide  Au sein du Collectif Urgence
Au sein du Collectif Urgence